Oý va-t-on avec líarticle 80 de la Constitution
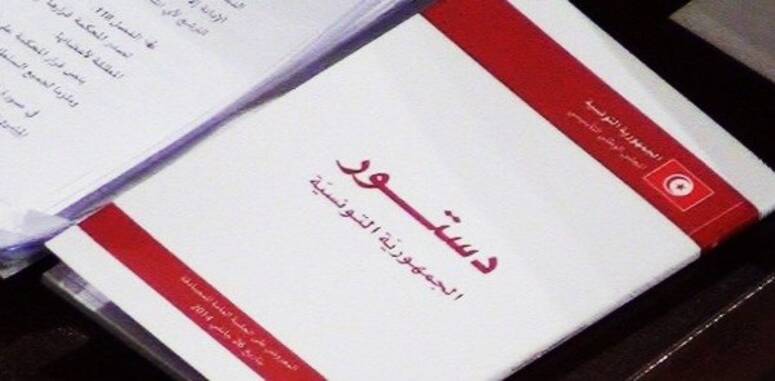
Habib AYADI
Professeur ťmťrite ŗ la Facultť des Sciences Juridiques,
Professeur ťmťrite ŗ la Facultť des Sciences Juridiques,
politiques et sociales de Tunis 2
A force de me taire, je suis moi-mÍme ŗ douter de mon passť (surtout comme professeur de droit public), cíest cruel.
Sauf ŗ síaffranchir des principes constitutionnels, líarticle 80 justifiant les dťcisions du 25 juillet ne correspond ni ŗ líarticle 80 de la constitution et encore moins ŗ líarticle 16 de la constitution franÁaise.
Pour mieux comprendre le rťgime de líarticle 80 il faut se reporter ŗ líarticle 16 de la constitution franÁaise.
Cet article a ťtť utilisť par le Gťnťral De Gaule en 1961 lors de la crise algťrienne. Il nía pas ťtť depuis utilisť par la France.
Ainsi, lors de la crise de mai 1968, il a prťfťrť aller en Allemagne pour rencontrer le gťnťral Massu, ancien commandant du comitť de salut public et ancien ę Algťrie franÁaise Ľ, commandant en chef des forces franÁaises en Allemagne, pour discuter de la neutralitť de líarmťe dans la crise. DŤs son retour ŗ Paris, il ordonne ŗ Georges Pompidou son premier ministre, de nťgocier avec les opposants.
Faut-il le rappeler, la constitution, c'est-ŗ-dire la Charte fondamentale, constitue les pouvoirs publics, dťtermine leurs attributions, rŤgle les modalitťsde leur compťtence et fixe les droits et les devoirs des citoyens.
La certitude rťside dans le caractŤre impťratif et contraignant de líordre constitutionnel positif (c'est-ŗ-dire de la lťgalitť constitutionnelle et sa suprťmatie).
Le Prťsident de la Rťpublique níest quíun serviteur de la Constitution et non son crťateur. Il doit síincliner devant sa suprťmatie. Plus concrŤtement, pour que le prťsident de la rťpublique puisse mettre en úuvre líarticle 80 de la constitution, il faut que la dťcision retenue, rťponde aux conditions exigťes par la constitution.
En Tunisie, líexercice des pouvoirs de crise (article 80 prťcitť) nía jamais ťtť utilisť, ni sous le Prťsident Bourguiba (Crise de 1978, 1984), ni 2011, lors de la crise libyenne, lorsque le sud tunisien a ťtť occupť par plus de cent mille de libyens et díťtranger.
Le Prťsident Bourguiba ainsi que díailleurs Ben Ali considŤrent avec hostilitť les pouvoirs de crise parce quíils offensent franchement les rŤgles dťmocratiques.
I-Líarticle 16 de la Constitution franÁaise
Prťcisťment líarticle 16 permet au Prťsident de la Rťpublique de se saisir de tous les pouvoirs en cas de nťcessitť. Motivťs par le souvenir de la crise de 1940, les dispositions de líarticle 16 sont sans prťcťdent dans la tradition rťpublicaine franÁaise. Il autorise líexercice díune dictature au sens romain.
A quelques formalitťs et conditions, sa mise en úuvre est laissťe au prťsident de la Rťpublique et on comprend quíil inspire et continue ŗ inspirer plus craintes aux citoyens.
Díailleurs, lors de la crise de mai 1968, le gťnťral De Gaulle ne lía pas utilisť : Il ne lía appliquť quíen 1961, suite aux dangers de líOAS (Algťrie-franÁaise), líattentat contre le gťnťral De Gaulle et le coup díEtat des quatre gťnťraux.
A-La mise en úuvre de líarticle 16
Pour que le Prťsident puisse mettre en úuvre líarticle 16, il doit respecter des conditions de fonds et de forme.
a) Les conditions de fonds, il faut que 1/ Les institutions de la Rťpublique, líindťpendance de la Nation, líintťgritť du territoire ou ses engagements internationaux soient menacťs díune maniŤre grave et immťdiate. 2/ Le fonctionnement rťgulier des pouvoirs publics a ťtť interrompu. Ces deux conditions sont cumulatives.
b) Les conditions de forme, le Prťsident de la Rťpublique doit procťder ŗ des consultations prťalables et officielles du Premier ministre, du conseil constitutionnel et des prťsidents des assemblťes. Il níest pas tenu de suivre leurs avis.
c) La dťcision de mise en úuvre de líarticle 16 est un pouvoir propre du Prťsident. Il ťchappe ŗ tout contrŰle juridictionnel quel quíil soit (CE 2 mars 1962 Rubin de Servers). Il níen est pas de mÍme des dťcisions rťglementaires qui pouvaient Ítre dťfťrťes au conseil díEtat pour excŤs de pouvoir.
B-Le rťgime juridique de líarticle 16 :
La mise en úuvre de cet article ouvre une parenthŤse dans líťtat du droit, normalement prťvu par la constitution.
Le prťsident de la Rťpublique est habilitť ŗ prendre les mesures exigťes par les circonstances. Ce qui revient ŗ dire quíil dispose pendant la durťe de líarticle 16 de la plťnitude du pouvoir exťcutif et lťgislatif. Ces pouvoirs níont díautres limites que líinterdiction de prononcer la dissolution de líassemblťe ou de procťder ŗ une rťvision de la constitution.
Síagissant des mesures díapplication de líarticle 16, il peut síagir de dťcisions (lťgislatives ou rťglementaires) ou des dťcrets (pour les mesures individuelles díapplication) pris par le prťsident et dispensť de tout contreseing.
Les dťcisions lťgislatives ťchappent ŗ tout contrŰle juridictionnel, il níen est pas de mÍme des dťcisions rťglementaires (CE Rubin de Servers 1962) surtout aux dťcisions individuelles díapplication qui ťgalement peuvent Ítre dťfťrťes au Conseil díEtat par la voie du recours pour excŤs de pouvoir (CE 23 octobre 1964).
Le gouvernement continue ŗ exercer ses fonctions habituelles, mais en respectant les mesures exigťes par les circonstances. Quant au parlement, il se rťunit de plein droit pendant toute la durťe de líarticle 16 et continue díexercer ses pouvoirs lťgislatifs et de contrŰle habituel du gouvernement.
Il peut donc censurer le gouvernement, voter des lois, mais son pouvoir est rťduit du fait de líarticle 16.
La durťe díapplication : On distingue entre la durťe díapplication de líarticle 16 et la durťe díeffets des dťcisions prises en application de cet article.
-La durťe díapplication de líarticle 16 doit se limiter au strict nťcessaire. Elle cesse dŤs que le fonctionnement rťgulier des pouvoirs publics est assurť. Mais dans la pratique, la dťcision de fin díapplication est laissťe ŗ líapprťciation du Prťsident.
MÍme si líarticle 16 est tombť en dťsuťtude, il demeure en vigueur car encore mentionnť dans la constitution.
II-Un Prťsident de la Rťpublique ę dťvoilť Ľ
Pour la Tunisie, on ne peut comprendre la portťe et la signification de líarticle 80 en se reportant ŗ líarticle 16 prťcitť.
Par ailleurs et surtout, le Prťsident KaÔs SaÔd a multipliť les mesures et les dťcisions illťgales concernant surtout des fonctionnaires. La connaissance de la jurisprudence administrative est utile parce quíelle permet aux fonctionnaires tunisiens de connaÓtre leur statut.
Comme líarticle 16, líarticle 80 de la constitution qui reprend líarticle 16 avec ses conditions de fond, forme permet au prťsident de la Rťpublique de se saisir de tous les pouvoirs en cas de nťcessitť. Cíest dans la conscience du Prťsident que les citoyens doivent trouver leurs principales garanties. On comprend dans ces conditions que líarticle 80 inspire aux citoyens les plus craintes, aux libertťs et ŗ la dťmocratie.
Dans líexercice des pouvoirs de crise, líarticle 80 prťcise que les mesures prises par le prťsident ont pour objectif de garantir les plus brefs dťlais, le retour au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
A lire les dťcisions du 25 juillet, on est frappť par le non-respect par le prťsident des conditions de fond et de forme, prťvus par líarticle 80. Ainsi que, díailleurs, les pouvoirs publics et services publics, Il est clair que rien ne justifie le recours ŗ líarticle 80.
En rťalitť, líarticle 80 apparait comme un simple paravent pour protťger líinconstitutionnalitť des dťcisions du 25 juillet. Plus gťnťralement, il níexiste aucun texte constitutionnel, lťgislatif et mÍme ŗ la limite rťglementaire autorisant le chef de líEtat díexercer ces pouvoirs et cumuler les trois pouvoirs : lťgislatif, judiciaire et exťcutif.
Tout se passe comme si KaÔs SaÔd a reÁu une rťvťlation líautorisant ŗ cumuler les trois pouvoirs et ŗ considťrer les dťcisions du 25 juillet comme ę supra constitutionnel Ľ et les dťcisions du Prťsident comme infaillibles. Et pourtant il est prťvu aisťment ŗ la constitution et notamment líarticle 72 que le prťsident est chef de líEtat et le symbole de son unitť. Il garantit son indťpendance et sa continuitť et veille au respect de la constitution.
Les juristes considŤrent cette forme de cumul des pouvoirs comme, non seulement contraire ŗ la constitution, mais ťgalement et surtout une usurpation du pouvoir.
En France, en 1961, le Gťnťral De Gaulle a fait recours ŗ líarticle 16 le 23 mars 1961, son utilisation est terminťe fin mai, mais le Gťnťral De Gaulle a prorogť ses effets jusquíau 29 septembre. Il a ťtť accusť díusurpateur.
Les pouvoirs exercťs par KaÔs SaÔdde depuis le 25 juillet constituent une usurpation du pouvoir et normalement níont aucun effet juridique.
1-Les faits accomplis
Pendant plus de dix ans de la rťvolution, les tunisiens attendaient un choc politique entrainant une transformation politique, ťconomique, financiere et sociale. Mais aucun dirigeant politique ou syndical nía osť entreprendre ces rťformes. Les gouvernements níont trouvť mieux que líendettement. Il en rťsulte que les dettes de líEtat ont atteint des niveaux dangereux et nous ne sommes pas loin de la situation de 1868 avec comme consťquences líinstallation en Tunisie, díune nouvelle commission financiŤre internationale.
Ces erreurs et inťgalitťs ont contribuť, díune maniŤre ou une autre, au dťveloppement de la crise du 25 juillet 2021.
Mais ces dťcisions du fait accompli ne peuvent durer longtemps et le retour aux rŤgles dťmocratiques est inťvitable.
2-La corruption
Aristote disait : ę On ne peut faire une symphonie avec une seule note Ľ. La politique actuelle du chef de líEtat se ramŤne ŗ une seule note rťpťtťe : la corruption comme síil níy a que ce seul problŤme et pourtant les problŤmes fiscaux, ťconomiques, sociaux sont aussi prioritaire. Pour ne citer quíun exemple, celui de la fraude fiscale.
En Tunisie, líťvasion fiscale est ťnorme et elle est mÍme garantissant. Les revenus dťclarťs par certaines catťgories de contribuables sont sans comme mesure avec leur revenu, leur accroissement visible de patrimoine et les ťlťments de train de vue.
En 2014, selon líťtude díun cabinet anglais, díaprŤs la rťvolution, le nombre de milliardaires a augmentť de 17 %, leur fortune annuelle reprťsente la moitiť du budget de líEtat. Díautre part, le coŻt de líťvasion síťlŤve ŗ 70 % des recettes fiscales.
Líťconomie informelle, fondťe essentiellement sur la contrebande reprťsente jusquíŗ 40% de la richesse nationale. Ces chiffres, certainement, se sont aggravťes parce quíil níy a pas depuis 2014 une politique de lutte contre la fraude.
Il est certain que la lutte contre la corruption est une politique noble et courageuse et qui fera de la Tunisie dans líavenir, un modŤle. Mais le respect de la constitution et les lťgalitťs sont aussi importantes.
Díabord la lutte contre la corruption, qui est de longue date, ne relŤve pas de la compťtence du Prťsident de la Rťpublique, mais des juges et de líadministration.
Certains pays, pour lutter contre la corruption ont crťť des ministŤres de la corruption et des juridictions spťcialisťes ŗ cet effet.
Par ailleurs, et síagissant de la fraude fiscale, ce qui la caractťrise actuellement en Tunisie la lutte contre la fraude, cíest un mťlange de paresse, du fanatisme et díincompťtence.
Dans les faits la lutte contre la fraude repose en premier lieu sur la capacitť de líEtat de dťtecter la fraude, c'est-ŗ-dire sur líadministration, seulement et en second lieu sur la loi et la sanction, car la simple connaissance par le contribuable que líEtat est en mesure de dťtecter la fraude peut ŗ lui-seul contribuer ŗ prťvenir la fraude.
En SuŤde, líadministration de finances est ramenťe ŗ cinq cents (500) fonctionnaires, le surplus est placť dans les agences.
Il síagit díune structure sťparťe du ministŤre des finances, dotťe díune autonomie de gestion et dirigťe par un conseil díadministration.
Ces agences sont au trois : líagence de contrŰle fiscal, agence de recouvrement et une agence de la douane. Ces agences ont donnť de bons rťsultats. La Tunisie dont síinspirer de cette expťrience, surtout, recruter des jeunes et les soumettre ŗ la mťthode ę information Ė recrutement Ľ.
Retour au peuple
Nous sommes aujourdíhui face ŗ une rupture radicale entre les classes sociales. Le pays a besoin de prendre des dťcisions douloureuses, car ceux qui ont gouvernť pendant dix ans níont pas traitť avec sťrieux les rťformes. En clair, la nouvelle situation du pays exige des rťformes quíaucun gouvernement prťcťdent nía osť entreprendre. Il níest pas pire faute que de cacher au peuple la rťalitť. Il faut tout dire au peuple : oý líon est, ce qui fonctionne et ce qui est en panne ťgalement, les dirigeants qui ont contribuť ŗ la dťgradation du pays.
Cela dit, on ne refait pas le passť. Comment sortir de cette crise profonde qui va malheureusement se maintenir.
Le ras Ė le bol des tunisiens est justifiť. Il est dangereux díopposer les catťgories les unes aux autres. Par ailleurs on ne peut pas continuer admettre des gouvernements sans le peuple et des ťlections par dťfaut.
Cela ťtant exposť trois remarques síimposent díemblťe ŗ líobservation.
1-Le premier est le mode ťlectoral
Le systŤme proportionnel, comme díailleurs ŗ la IV Rťpublique a fait le malheur de la Tunisie. Il a tuť la politique et exclu de la compťtence politique ceux qui pourraient porter une parole appelant ŗ la rťforme.
Sur plus díun point, les divers gouverneurs issus de la rťvolution de 2011 rappelle la situation de la IV Rťpublique. A líťpoque on reprochait au rťgime de la IV Rťpublique díÍtre un rťgime faible. Des coalitions mal ficelťes et incapables de trancher et de dťcider. Ils ont conduit ŗ líimmobilisme et ŗ líimpuissance.
Comme le personnel politique franÁais, les gouvernements tunisiens qui se sont succťdťs aprŤs la rťvolution ont pour devise, en matiŤre politique, ne rien faire tout en donnant líillusion de líaction.
En France, la crise de líIVŤme Rťpublique a finalement trouvť une solution par líappel ŗ une personnalitť hors norme, Le Gťnťral De gaule. Il a ťtť inverti en 1958 par la chambre des dťputťs avec les pleins pouvoirs.
En Tunisie en líabsence díun prťsident de la Rťpublique jouissant díun charisme et de líautoritť pour convaincre de la nťcessitť des sacrifices exigťs, il faut conseiller díappliquer ce qui a marchť dans díautres pays, notamment la France, plutŰt que ce que plait ŗ certains dirigeants. Pour faire court, il est nťcessaire que líassemblťe actuelle dťsigne un gouvernement de compťtences . A dťfaut, dissoudre líassemblťe actuelle et procťder ŗ des ťlections ou un nouveau mode ťlectoral et des nouvelles bases dignes des aspirations de la rťvolution.
2-La deuxiŤme est sans doute líincapacitť des dirigeants qui ont pris le pouvoir aprŤs la rťvolution, ŗ traduire en dťcisions cohťrentes les attentes du corps social.
Il est frappant que ces dirigeants rťagissent comme síil níy avait pas eu de rťvolution et comme si le pays níťtait pas rťellement plongť dans une profonde crise ťconomique et sociale.
Ils níont pas compris, que pour la majoritť des tunisiens, la rťvolution est beaucoup moins la conquÍte du pouvoir politique, que líintroduction dans la sociťtť tunisienne de valeurs nouvelles impliquant une rťorganisation des rapports essentiels, c'est-ŗ-dire non seulement líaccŤs ŗ la libertť et ŗ la dignitť mais ťgalement et surtout ŗ la justice sociale. Mais les nouveaux acteurs politiques qui níont pas pris ou ont pris tardivement la rťvolution, líont vite rťcupťrť, líont enfermť dans le passť.
Ils níont pas compris ťgalement quíil síagit díune rťvolution socio-ťconomique qui se distingue de la rťvolution politique par líampleur des transformations.
3-Le troisiŤme : Le droit des jeunes tunisiens au travail
Les jeunes tunisiens ne croient plus au pŤre Noel fut-il coiffť díun Chapka.
Les inťgalitťs sont chaque jour plus criantes, líinvestissement est en berne et líťduction en petite forme.
Le taux de chŰmage des jeunes, qui síaccentue de jour en jour pour attendre 40% et pourtant la Tunisie dispose des cadres de haut-niveau. Aucun effort nía ťtť effectuť pendant les dix derniŤres annťes.
En 1993, la SuŤde, en difficultť ťconomie a procťdť ŗ une nouvelle politique en matiŤre díemploi a prťvu une nouvelle politique díemploi basťe sur la rŤgle ę formation-recrutement Ľ. Elle a donnť díexcellents rťsultats.
A moins de retourner en arriŤre, il est nťcessaire díadmettre que la crise ťconomique, financiŤre et sociale ne peut se rťsoudre, en promesse et en lutte contre la corruption. Les rťalitťs se vengeront quand les crises qui rŰdent autour de nous, quand la concentration des richesses et des pouvoirs sera insupportable, le peuple se rťveillera.
Faut-il le rappeler, dans le temps moderne, les rťvolutions níont pas besoin díťclater pour produire les effets. Les tunisiens modestes ou les chŰmeurs níont quíŗ affirmer leurs revendications dont líessentiel tiennent au chŰmage, ŗ la pauvretť et la dťgradation des moyens de la masse.






















Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 232408